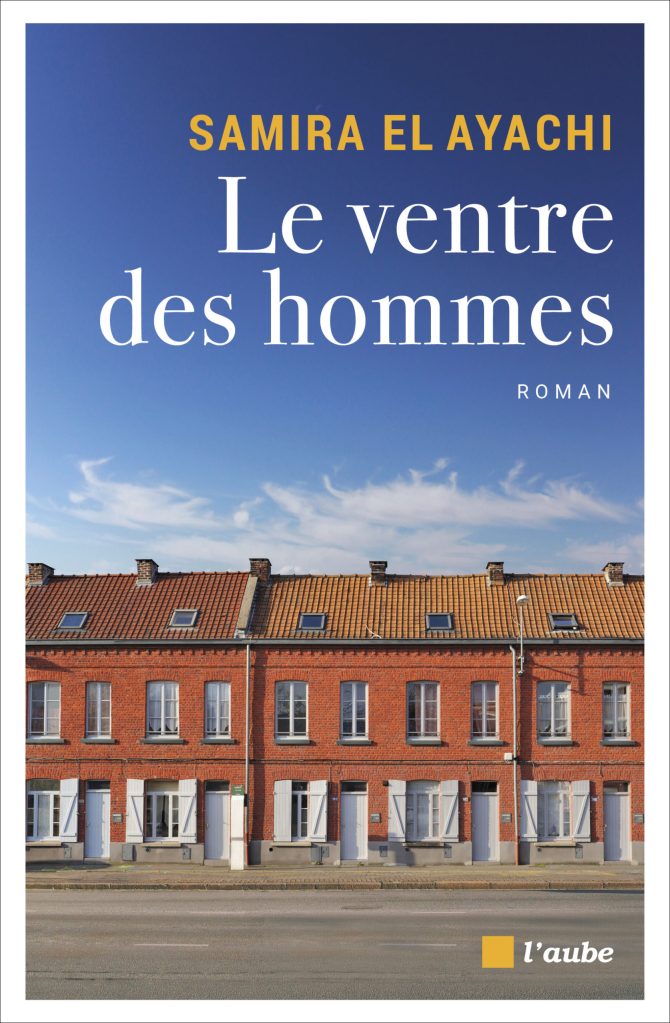Sorte de carnet d’un retour au pays natal, celui de l’écrivaine française sur ses terres des corons, Le ventre des hommes est le troisième roman de l’autrice. Echange sur une presque autobiographie libératrice, et sur le pouvoir langagier de la révolte.
Après plusieurs difficultés à nous croiser, et alors que la contestation sociale fait rage dehors, nous nous rencontrons enfin. Nous sommes le 7 mars, et l’heure de la manifestation contre la réforme des retraites approche. Une mobilisation que nous évoquons, Samira El Ayachi et moi, en plus de discuter son roman Le ventre des hommes, publié au format poche en janvier dernier aux éditions de L’Aube. Quelle coïncidence alors, que cet article soit publié quelques jours seulement après le 23 mars, autre grande journée de mobilisation en France.
Mais pourquoi rapprocher le parcours personnel de l’écrivaine, et a fortiori sa dernière fiction, à un mouvement de contestation ? Et bien tout simplement parce que la lutte sociale fait partie intégrante de Samira El Ayachi et son œuvre. Puissant et émouvant, Le ventre des hommes s’inscrit dans l’histoire personnelle de son autrice. Elevée dans le bassin minier de Houillères, elle découvre très jeune que son père , venu en France depuis le Maroc pour travailler dans les corons, est porte-parole de la cause des mineurs marocains du Pas-de-Calais. Une révélation qui servira, quelques décennies plus tard, du point de départ pour créer Hannah et son père Mohammed dans son dernier roman.
Impossible de ne pas vous demander, en question d’introduction, quelle est la part autobiographique de votre roman ?
Il est inspiré de mon histoire familiale. Mais c’est un peu plus qu’autobiographique, car je ne connaissais pas ce monde avant de l’écrire. En découvrant des éléments issus de mon histoire familiale, j’ai eu l’impression que l’écriture de ce texte me reconstruisait, qu’il était une part manquante de mon héritage, une histoire que je ne connaissais pas. Il m’a à la fois construite et reconstruite.
Avez-vous un souvenir marquant à raconter de la découverte et de la préparation de cette histoire ?
Il y en a plusieurs. Quand j’ai démarré mes recherches en 2010, j’avais très peu de sources. Je savais que mon père avait été mineur, que les mines avaient fermé, mais je n’avais pas beaucoup d’éléments. Au même moment, l’État français posait à ses citoyens la question très étrange de l’identité avec ce fameux ministère de l’identité nationale [décrié, il a existé entre 2007 et 2010 lors de la présidence de Nicolas Sarkozy, NDLR].
Je découvrais cette histoire-là à ce moment précis, et ça a joué de voir que l’État français demandait à ses enfants de dire qui ils étaient. C’était l’effet d’une désillusion. J’ai alors repensé à mon enfance : tandis que je m’y construisais, l’État cherchait des éléments pour mettre ma famille dehors. Un autre élément que je trouve beau ce sont les rencontres qui entourent l’écriture de ce roman. Comme je n’avais pas de sources, j’ai interviewé. Il y avait un silence sur cette question-là dans mon environnement familial, ou un oubli, et mon travail de romancière a été de creuser les silences et les trous. J’ai décidé de rencontrer Abdellah Samate, le fondateur de l’association des mineurs marocains du Nord (AMMN), et quand je suis allée à sa rencontre il m’a annoncé qu’il voulait déjà me rencontrer pour savoir si j’étais bien « la fille de (mon) père », ce que je n’ai pas compris. Il m’a installée chez lui et m’a montrée une vidéo. C’est cette scène qui ouvre le roman : je voyais mon père prendre la parole au JT de France 3. C’était très beau, je ne savais pas du tout que mon père avait été porte-parole des mineurs. Je suis ensuite allée au centre historique de Lewarde et je suis tombée sur des tas d’archives et une grande histoire qu’on risquait d’oublier si on ne la regardait pas en face. Je n’ai pas trouvé mieux que le roman et la fiction pour la raconter.
Comment était l’enfance dans le bassin minier ?
Comme l’enfance d’Hannah. J’ai choisi de raconter, car ce sont les souvenirs que j’en ai, que même si on habite dans les corons et dans le Nord, toute enfance est toujours lumineuse. Les souvenirs que j’en ai sont ceux que je raconte dans le roman : la liberté, la vie libre pour des enfants. Les maisons sont trop petites, donc la rue tout entière est un terrain de jeu. Toutes les langues autour de moi, et le sentiment que j’avais un pouvoir car je savais lire et écrire, comparé aux adultes qui m’entouraient. La découverte de l’intimité avec les livres…
Si votre roman a originellement été publié l’année dernière, sa réalisation est ancienne. Quel a été l’élément déclencheur pour vous lancer dans ce chantier ?
Je voulais faire connaitre cette histoire. Je l’ai écrit avec un sentiment d’urgence, car les témoins sont en train de vieillir ou de partir. J’ai eu le sentiment de venir réparer quelque chose, et je pense que c’est pour ça que je l’ai écrit, pour ré-humaniser ces hommes réduits à de la force ou des bras, par une partie de l’Histoire. J’ai donné à voir ce qui a été sciemment occulté par les recruteurs de l’époque : l’amour, la famille, leurs rêves, qui ils étaient. Et c’est grâce à la fiction qu’on peut se mettre à la place du père, de ces hommes et de ces femmes. Je propose au lecteur une traversée de ce que c’est que d’être accueilli par un pays qui vous réduit à des bras et qui ne voit pas tout ce que vous apportez au territoire.
J’ai précisément rappelé que ce sont des êtres de langage, qui arrivent avec un imaginaire qui nourrit le territoire du bassin minier, pour permettre au lecteur de voir tout ce qui a été vécu. Mais ils ne sont pas victimes : je n’ai pas voulu porter un regard misérabiliste sur eux. A la place, j’ai voulu montrer leur puissance langagière, la puissance de la lutte, des sujets qu’ils sont devenus. Ce qui est beau c’est qu’envers et contre tous, dont l’État français, ils ont accompli un destin et une promesse française : celle de devenir un individu qui fait des choix, qui se bat et utilise des outils de la démocratie.
Vous parlez de puissance langagière : dans votre texte, la langue est très puissante. Quelles étaient vos inspirations artistiques pour arriver à une telle écriture ?
Pour ce roman, qui est très différent du reste de ma bibliographie, j’ai beaucoup lu Annie Ernaux. C’est une langue très simple, pleine d’images. J’ai aussi lu Albert Camus et l’Étranger, le Retour à Reims de Didier Eribon aussi. Moi, je fais mon retour à Lens. Je les cite tous dans Le ventre des hommes. J’y ai également introduis la langue amazighe, cette langue berbère peu connue. Chants, poèmes berbères, polonais, italiens… Il y a beaucoup de références à la culture populaire dans mon texte. Même du Jean-Jacques Goldman !
Votre histoire est bicéphale, racontant d’un côté l’histoire d’un père et de l’autre celle de sa fille, s’appuyant sur votre histoire et sur des archives qui parsèment le récit. Comment en venir à un tel mélange de narration ? Et comment ne pas perdre le fil de son écriture quand elle fait face à autant d’éléments ?
Raconter 50 ans d’histoire, ce n’est pas évident. Mais j’ai toujours voulu l’écrire à partir de notre époque, c’est pour ça qu’elle est avant tout racontée au travers des yeux d’Hannah : c’est une histoire d’amour entre une fille et son père. Pour la raconter, j’avais besoin de planter le décor d’une France où on avait perdu l’insouciance collective. Donc je l’ai posée un an après les attentats de 2016. Ça m’a aidée à récupérer la part d’indocilité dont j’ai besoin et qui manquait à l’époque. Je voulais que cette histoire soit racontée de l’intérieur par celles et ceux qui l’ont vécue. J’ai eu besoin que le père la raconte avec ses mots : pas comme un illettré, mais comme quelqu’un qui a aussi un pouvoir langagier, dans la langue arabe. Je trouvais intéressant qu’en fin de compte la fille ne maitrise pas la langue arabe littéraire. Qui est l’illettré alors ?
Et concernant les archives ?
Elles servent à montrer que cette histoire dépasse ce qu’on peut imaginer. C’est une histoire contemporaine qu’on n’a jamais pris le temps de regarder en face. Mettre des archives raconte beaucoup de choses sans qu’on ait besoin d’en rajouter, elles sont leur propre langage.
Vous parlez beaucoup du père dans votre texte, mais qu’en est-il de la mère, que vous mentionnez partiellement. Pourquoi s’être concentrée sur l’histoire du père ?
Ces mères ont d’abord été oubliées par les Houillères : les hommes embauchés étaient considérés administrativement comme célibataires, pour ne pas faire de regroupements familiaux. Elles ont été trimballées par l’Histoire, alors qu’elles ont joué un rôle immense. J’ai découvert que ce sont elles qui voulaient rester et qui ont demandé à leur mari de se battre. Elles avaient subi un premier exil, on leur demandait d’en vivre un autre, et ce n’était plus possible pour elles. Elles avaient fondé des relations, reconstruit leur vie en France. Volontairement, ce sont les grandes oubliées. Mais elles sont aussi des rebelles : elles ont voulu rester dans leur langue. Comment se fait-il que pendant 40 ans de vie en France elles n’aient pas appris le Français ? Je pense que c’est avant tout un acte de rébellion. Elles y ont vu une richesse dont tout le monde se privait et ont voulu la garder absolument. Il y a un oubli des paternels, et dans ce roman j’ai voulu qu’il y ait un vrai hommage aux langues maternelles.
Si la mère est oubliée, une figure féminine est centrale : Hannah. Elle est à la fois une femme et une petite fille qui raconte des histoires.
Je ne me suis mise à la place d’un personnage masculin dans un seul de mes romans, 40 jours après ma mort. Pour Le ventre des hommes ce point de vue m’intéressait parce que c’est aussi une enfant qui doit à un moment donné se confronter à son père. Et comme mon personnage recherche sa part d’indocilité, elle doit s’opposer aussi au père. Mais c’est difficile de s’opposer à une telle figure. Quelque chose qui me traverse beaucoup, est qu’une fille sera élevée pour être plus docile vis-à-vis des institutions, des règles. Et chez Hannah il y a cet acte de rébellion contre le père mais aussi contre l’autorité, puisqu’elle va commettre un acte répréhensible au sein de l’Éducation Nationale. Et il y a un parallèle clair, je pense, entre l’opposition au père et aux figures d’autorité d’une société. C’est important pour une femme de se rebeller contre des structures patriarcales et de domination.
Hannah est un personnage ambigu, prisonnière d’un sentiment d’amour profond de la France face à un paysage politique français post-attentat qui la rejette. Quel regard vous portez sur cette dualité ?
Je ne pense pas qu’il y ait une dualité, juste un amour profond pour la France, depuis son enfance. Nous n’avons pas entendu ces millions de gens qui composent ce territoire, pour qui les attentats ont été très douloureux, qu’ils ont ressenti dans leur chair. Ce moment-là, elle l’a vécu comme son père, comme une tragédie. Elle ne comprend pas pourquoi le pays se déchire. C’est représenté par ce lien entre Nils et elle : leur amour est intense et ils s’apportent beaucoup, mais et un jour il la repousse. J’avais envie de donner la parole à une famille marocaine, une femme née de parents marocains très ordinaires, et de voir comment ils auraient vécu ces attentats.
Les répercussions de l’attentat ont donc été très importantes pour votre roman?
C’est un drôle de moment que les gens ont vécu en 2016 : on leur a demandé de se dire qu’ils n’étaient pas… c’était complètement hallucinant et d’une violence sans nom. C’est comme si on répétait l’histoire, en réduisant l’autre à une religion qu’il a déjà dépassée, ou à une assignation dont il s’est déjà libéré. Elle vit la répétition d’une histoire et d’une douleur, commencée dès l’enfance. Lorsqu’elle retourne dans le bassin minier, elle observe des affiches du front national, du RN qui gagne, la fin des villes communistes. Des tas de violences symboliques qui se succèdent. Mais à côté de ça, et ça m’a beaucoup apaisée de l’écrire, j’ai compris que la France, ce n’est pas l’État français. Il y a aussi toutes les solidarités qui sont survenues, pendant les grèves de la part des voisins, des mères. C’est un hommage rendu à cette part de la France, toutes celles et ceux qui pointent du doigt les zones de non-droit. Je me suis rendue compte que la France c’est ceux qui luttent, qui seront dans la rue aujourd’hui.
Votre personnage fait un acte de désobéissance civile, qui est de ne pas suivre le plan Vigipirate en cas d’attaque terroriste. Un acte que vous décrivez comme un libérateur. Pourquoi l’avoir présenté comme tel ?
Parce que c’est ce qu’a fait son père, c’est comme ça que les choses avancent. Est-ce qu’on peut se regarder dans une glace quand on applique des règles qui renvoient à une forme d’éthique ? J’ai interrogé cinq professeurs pour construire le personnage d’Hannah, et parmi eux, certains ont refusé d’effectuer ces exercices. Ils les perçoivent comme terrifiants et terrorisants pour certains de leurs élèves. On est un an après les attentats, donc le traumatisme est encore présent. J’avais envie de protéger l’imaginaire de la jeunesse et des enfants.
Aujourd’hui, désobéir, c’est continuer à croire en l’autre. Ce n’est pas forcément casser, mais tendre la main, continuer à fréquenter l’autre et le rencontrer. Une société qui avance se construit aussi par la désobéissance. Pour moi, l’acte de désobéissance, c’est d’écrire des romans, ça relève de la transgression : on transgresse par l’imaginaire, on propose d’autres lectures. La lecture qu’Hannah et moi proposons c’est de dire qu’après les attentats (et pendant les mouvements de grève et de contestation) tout le monde est plongé dans une forme de peur ou de terreur et qu’elle est une fiction. A cela, Hannah et moi-même, ou les écrivains, proposons de continuer à croire en l’autre, de continuer à construire un monde de solidarité où des valeurs comme la sororité, l’égalité et la liberté sont au-dessus de tout et quand celles-ci sont malmenées par des institutions on a le devoir de désobéir. Hannah a le devoir de protéger l’enfance et son imaginaire, parce que notre époque a cruellement besoin de ça. Je propose au lecteur un voyage vers son enfance, et j’espère qu’en tant que lectrice, tandis qu’Hannah repartait dans son enfance, vous aussi vous alliez rechercher la vôtre. Nous avons besoin d’imagination aujourd’hui, car un monde sans imagination est très dangereux.
Mais pourquoi en faire un acte libérateur ?
Il y a toujours un acte de désobéissance premier qui nous fonde : c’est le premier non au père, la première désobéissance à la mère, la première mauvaise note à l’école, l’école buissonnière. Et pour rechercher cet acte là j’invite tout le monde à se souvenir de ce moment où, pour se construire, on a posé un non. Il est utile et nécessaire. Pour moi c’est le moment où j’écris : mon premier acte de transgression, c’est l’écriture. Mais c’est intéressant que chacun se souvienne qu’il porte en lui cette mémoire de la désobéissance, et que c’est quelque chose de propre à notre France, qui constitue notre histoire et notre mémoire. Les grèves, les manifestations, la Révolution française : un non est posé, qui ouvre ensuite la voie à autre chose. Mais il est essentiel, ce non. Il a besoin de s’exprimer, se nourrit du collectif. Il y a un premier non et d’autre suivent, ça donne un mouvement.
Quel regard portez-vous sur la protestation actuelle contre la réforme des retraites ? Et sur les syndicats ?
Je donne la part belle aux syndicats et aux luttes collectives dans mon roman. Mon héroïne, comme moi, a une forte nostalgie des luttes collectives, qui ont été cassées par Margaret Thatcher en ce qui concerne les mineurs, ce qui a ouvert la voie au capitalisme à outrance dans les années 1990. Je trouve essentiel et sain pour une démocratie qu’il y ait un contre-pouvoir. Que notre entretien ait lieu le jour-même d’un blocage national, évidemment, ce sont des choses qui me touchent. Je suis très émue, il y a quelque chose qui touche à la liberté, à la dignité, aux individus qui reprennent leur part politique et qui ne la laisse pas entre les mains d’autres.
Propos recueillis par Mathilde Trocellier.
« A’Samar. J’aime la nuit. D’ailleurs c’est la nuit que je suis née. C’était un samedi. On s’en souvient tous. Le problème avec la Nuit. C’est que la Nuit y a personne pour emmener maman à l’hôpital. Parce que papa est à la mine, au travail de nuit. »
Le soir tombe sur les corons du nord de la France, et une fratrie se presse devant l’écran de télévision. Soudain apparaît le visage attendu : celui du père. Qu’y raconte-t-il ? À l’époque, personne ne s’en soucie vraiment. Ce n’est qu’une fois adulte qu’Hannah, devenue enseignante et aux prises avec les règles imposées, découvrira l’histoire incroyable de son père et d’un groupe d’hommes venus du sud du Maroc pour travailler dans les mines de charbon. À travers ce roman d’une force inouïe, Samira El Ayachi lève le voile sur un pan méconnu de notre histoire collective, celui de la course à l’énergie au tournant des années 1970, du combat de trois mille hommes pour faire valoir leurs droits, et nous pose cette question : « Que reste-t-il du pouvoir de transgression que nous lègue l’enfance ? » Tout simplement sublime.